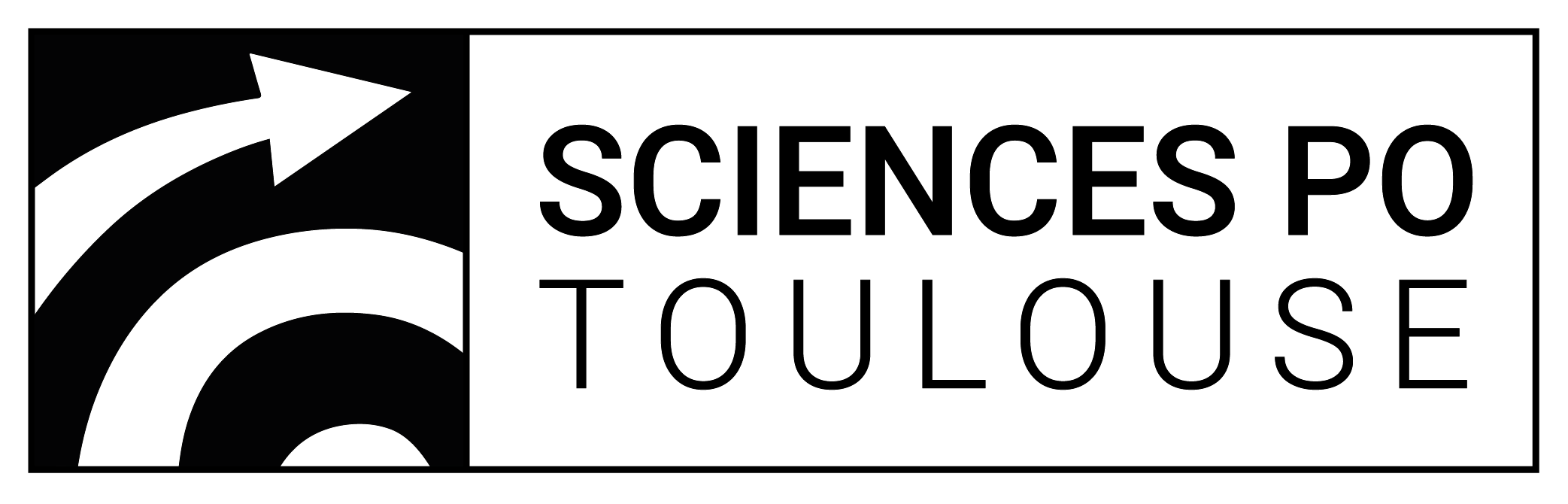En Bref
- Structure(s) de rattachement
- Durée de la formation
-
- 2 ans
- Stage(s)
- Oui, obligatoires
Aller au contenu Navigation Accès directs Connexion

Chargé.e de mission Concertation & Transition énergétique, chargé.e de mission dans une métropole, chargé.e de mission santé/environnement, chargé.e de mission sensibilisation au développement durable, chargé.e de mission tourisme, conseillère mobilité, consultant.e énergie et innovation Consultant.e en mobilité durable
Le parcours ambitionne de former des cadres à préparer la transition écologique, à gérer les risques et les incertitudes liées aux enjeux environnementaux, sanitaires ou industriels et animer les instruments et les politiques qui en découlent (RSE, Plan vert, PCAET, diagnostics territoriaux, bilan carbone, stratégies de développement durable, DDRS, ESG, retours d’expérience, cartographies de controverses, etc.).
Vous avez un niveau bac +3 et vous souhaitez intégrer Sciences Po Toulouse ?
Le concours de 4ème année permet d’accéder au diplôme de Sciences Po Toulouse, dans l’une des spécialités de cycle master proposées par l’établissement.
Objectif du cours :
Le cours présente le management et son histoire dans une perspective critique en montrant ses conséquences politiques et sociales en matière d’égalités professionnelles. Conduire les équipes, les projets et le changement est une des compétences majeures attendue des futurs cadres supérieurs de l'État et des collectivités territoriales comme des entreprises et des ONG. Ce cours a pour objectif de transmettre les connaissances fondamentales du management qui sont transversales aux principaux champs disciplinaires des sciences de l'organisation (gestion des ressources humaines, contrôle de gestion, systèmes d'information, finances, marketing...). Les grandes fonctions qui existent dans les organisations publiques et privées seront abordées ainsi que les théories qui éclairent les pratiques récentes en matière de management. À ce titre, ce cours s’intéresse directement à la thématique des égalités professionnelles dans toutes ses acceptions : inégalités de genre dans le monde professionnel mais aussi démocratie d’entreprise et égalité des parties prenantes dans la gouvernance des organisations.
Compétences acquises à l’issue du cours :
Ce cours passe en revue les politiques susceptibles de rehausser durablement la croissance de l'économie française. Quatre grands thèmes seront abordés :
Le cours proposera dans un premier temps un rappel général sur la croissance économique et sur les limites d'une politique qui ne serait fondée que sur ce seul objectif, avec une attention particulière portée à la question des inégalités et de le développement durable. Chaque séance sera ensuite l'occasion d'analyser les politiques mises en place en France, et de faire un lien avec l'actualité. Parmi les mesures qui seront abordées : le crédit impôt recherche, les pôles de compétitivité, les garanties de prêts aux PME, la fiscalité du capital, les allègements de charge au voisinage du SMIC (dont CICE et pacte de responsabilité), les réformes récentes du marché du travail (la loi El Khomri, ordonnance Macron, réforme de l’assurance chômage, etc..), les emplois d'avenir, la formation professionnelle, etc.. Le cours invitera les étudiants à réfléchir sur le bien fondé des politiques économiques menées au cours des dernières années, dans la mesure du possible d'une manière objective et non partisane à l'aide des méthodologies d'évaluation économique des politiques publiques. Il n’exige pas de connaissances préalables en économie, et ne fait appel à aucun formalisme mathématique.
Ce cours traite des enjeux et des modalités de la fabrique contemporaine du droit. Après un éclairage sur le débat relatif à la crise que connaîtrait la régulation juridique et les politiques publiques visant à y remédier, cet enseignement est conçu comme une initiation à la légistique. Cette dernière, que l’on peut définir à ce stade comme la discipline se rapportant à la conception des textes juridiques, sera l’occasion d’aborder les thèmes suivants : accessibilité et intelligibilité du droit, codification, consolidation, évaluation et expérimentation normatives, lobbying et participation citoyenne, élaboration de la loi sous la Cinquième République, etc.
Une activité facultative prolonge cet enseignement au second semestre et permet à celles et ceux qui le souhaitent de s’initier à la rédaction normative, dans une perspective plus pratique.
Ce cours souhaite étudier la place et le rôle de l’Europe dans l’organisation d’un système mondial à l’époque contemporaine en réfléchissant, chemin faisant, à ce qui fait les spécificités de l’Europe dans ces dynamiques. Comment conçoit-elle le monde et son organisation ? Comment se définit-elle aussi dans ses relations au monde ? Ces spécificités font-elles identité ?
Le temps long de l’analyse, deux siècles, doit permettre de creuser ces questions tout en réfléchissant aux accélérations et aux ruptures majeures dans cette relation (1914 ? 1945/47 ? 1990 ?). Après avoir étudié comment l’Europe se définit en tant qu’ensemble de valeurs tout autant que système de régulation, nous étudierons ce que la transformation de sa place dans le monde, de la domination sans partage à la marginalisation, fait au système et à ses différents acteurs.
Ce cours est une formation assurée par l’Institut de Formation Carbone se déroule en E-learning (environ 15 h) et sur une journée de formation en présentiel. Elle permet de présenter la méthode et les outils pour réaliser un bilan GES réglementaire. Avec le Bilan Carbone®, les décideurs publics et privés disposent d'un moyen efficace pour initier et piloter la réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à leur activité. La méthode permet de réaliser le bilan des émissions de GES des activités industrielles ou tertiaires, du patrimoine et des services d'une collectivité territoriale, de l'ensemble des activités d'un territoire. En l'utilisant de manière complète et appropriée, chacun pourra limiter sa contribution au changement climatique, et diminuera par la même occasion sa dépendance économique aux énergies fossiles. C’est donc un outil essentiel pour préparer à la transition des organisations.
Cette formation permettra aux étudiant.e.s de :
- posséder une vision synthétique des principaux enjeux de la lutte contre le changement climatiqueÀ l'issue de la formation, l’étudiant.e se voit remettre l'ensemble des supports pédagogiques en format électronique, une attestation et un Bon pour licence d'utilisation du Bilan Carbone®
La responsabilité sociétale de l’entreprise, déclinaison du développement durable au niveau de l’acteur économique, désigne donc l’intégration de préoccupations sociales et environnementales dans les activités commerciales et la prise en compte des parties prenantes internes et externes impactés par les effets négatifs de celles-ci. Par sa démarche RSE, l’entreprise entend être citoyenne, dans l’ensemble de sa sphère d’influence. Cette démarche initialement purement volontaire et relevant de l’éthique des affaires est aujourd’hui saisie par le droit. De nombreuses pratiques de RSE sont ancrées dans des obligations légales imposant de rendre des comptes et de prendre en compte le volet extra financier de leurs activités, notamment en déployant des procédures de vigilance. L’objet de ce cours, centré sur les risques industriels et les enjeux environnementaux, est d’analyser les grands concepts de la RSE et de souligner son évolution normative (pratiques commerciales responsables, consommation durable, implication écologique des salariés). Une partie du cours sera consacrée à la réalisation d’un Serious Game (AMORSE https://www.le-serious-game-rse.fr/ )
Aménagement durable et transition (11h)
Ce séminaire entend donner un aperçu des relations entre aménagement, urbanisme et enjeux écologiques. Ce cours reviendra sur l’histoire de l’aménagement et de l’urbanisme depuis le XIXe siècle, avec une attention plus particulière aux politiques publiques qui ont visé à organiser les usages de l’espace, et à la diversité des parties-prenantes de l’urbanisme selon les territoires considérés. Gestion spatiale des activités industrielles, des rapports entre propriété privée et utilité publique, procédés d’enquête publique, élaboration de pratiques, de théories, d’institutions et d’un droit de l’urbanisme, enjeux de mise en valeur et de patrimonialisation de certains espaces urbains, de ménagement des espaces naturels, de protection des paysages et de services écosystémiques, intégration de la nature dans des projets urbanistiques de grandes ampleur comme les villes nouvelles, périurbanisation, élaboration de documents d’urbanisme (des POS aux PLUi), gestion des infrastructures de transport de leur élaboration à leur maintenance, métabolismes des territoires, seront autant d’aspects susceptibles d’être examinés au cours de ces séances. Ces héritages matériels et institutionnels sont les cadres à partir desquels ont aujourd’hui à se déployer les politiques de transition territoriale. Des cités-jardins aux éco-quartiers en passant par les missions d’aménagement touristique ou les plans de construction puis de requalification des grands ensembles, les séances reviendront sur des exemples de tentatives concrètes de se déployer différemment dans l’espace pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux qui n’ont cessé de se poser.
Adaptation des villes au changement climatique : quels besoins de transition voire de transformation pour la résilience territoriale, (9h)
Ce séminaire s’organise autour de deux sessions de 4 heures. La première précisera les rappels sur les impacts et enjeux territoriaux et économiques du changement climatique, avec un zoom sur les vulnérabilités urbaines. Quelles réponses pour l'adaptation des villes au changement climatique ? Qu'est-ce que la résilience territoriale ? Sur quelle(s) dimension(s) repose-t-elle ? La seconde organisera un atelier de mise en situation sur un choc systémique : à partir de la lecture d'un récit de choc (canicule extrême longue et intense 2035), quelles sont les forces, les faiblesses et les manques, quels sont les défis qui émergent ?
Organisé avec d’autres écoles d’enseignement supérieur du site toulousain (l'École nationale supérieure d'architecture de Toulouse, l'Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse et le Master Urbanisme et aménagement de l’Université Jean Jaurès de Toulouse), cet atelier vise à faire travailler ensemble en mode projet les étudiant.e.s issu.e.s de ces différents cursus (architecture, ingénieries, urbanisme et sciences politiques) sur un territoire concret (en l’occurrence en 2023, le canal latéral à la Garonne). Il s’agit à la fois d’établir un diagnostic pluridisciplinaire des usages, enjeux et problèmes que rencontre ce territoire ainsi que de proposer un ensemble de préconisations à destination des acteurs publics (Toulouse Métropole et AUAT). Une semaine entière est notamment balisée afin d’arpenter le territoire, de pouvoir enquêter in situ et de travailler en groupes mélangeant les différents cursus afin de rendre possible un véritable échange entre les diverses compétences rassemblées par cet atelier interformations.
Économie, société et environnement naturel constituent des systèmes en coévolution, de sorte que les fonctionnements des uns impactent directement celui des autres, et inversement. Les règles de fonctionnement de nos sociétés, qu’elles soient politiques (règlements, lois…), sociales (habitudes, pratiques…) ou économiques (organisation marchande, contrats…) impliquent des rapports particuliers à l’environnement naturel et génèrent différents impacts. Comprendre les transitions requiert une connaissance approfondie des institutions économiques. La première partie du cours présente donc les fondamentaux de l’économie des institutions, et ceux des mécanismes micro et macro à l’œuvre dans les processus de transitions. Questionner la manière dont ces institutions économiques et sociales fonctionnent constitue un exercice important pour identifier tant les verrous que les stratégies de changement. La deuxième partie du cours propose un apprentissage des fondamentaux de l’économie écologique, située au croisement de l’économie et de l’écologie, et de ses pistes pour penser les enjeux de soutenabilité.
Ce cours propose une initiation aux Science Studies, c’est-à-dire à une analyse de la science (tant ses concepts que ses disciplines, ses acteurs ou ses institutions) par le prisme des sciences sociales. Dans cette perspective, l’activité scientifique est fondamentalement pensée comme une activité sociale, explicable par des causes liées à l’organisation sociale, économique et politique des sociétés : en termes matériels, en analysant les intrications profondes entre sciences, techniques et aspects socioéconomiques (capitalisme, division genrée de l’espace social, etc.) ; en termes historiques, en retraçant un phénomène de spécialisation, de professionnalisation mais aussi d’enfermement de la science ; en termes politiques, enfin, en revenant sur les débats contemporains autour des technosciences et de leurs effets. Sous cet aspect, on abordera la thématique des risques pour laquelle il existe un segment savant dédié. Outre une compilation de plus en plus riche de cas empiriques (situations de crise, risques diffus, monographie d’institutions, etc.), on y trouve un véritable travail collectif d’approfondissement théorique autour de nombreuses notions (risques, crises, incertitudes, menaces, etc.), faisant de cet espace de production scientifique un segment très dynamique et prometteur puisqu’il permet de penser à nouveaux frais de nombreuses questions fondamentales des sciences sociales (la question du lien social, de la légitimité des institutions, de la gouvernabilité des sciences, etc.). Ce cours vise ainsi à présenter ce champ de recherche autour d’une approche constructiviste des risques, considérant que ceux-ci sont avant tout des constructions sociales, des façons de nommer et de gérer de nouvelles menaces marquées par l’incertitude et que la science ne peut plus résorber. Sans aller jusqu’à postuler l’existence d’une « société du risque », il s’agira ainsi de comprendre en quoi la forme « risque », construite et mobilisée pour affronter certains enjeux inédits, transforme les configurations sociales dans lesquelles elle est produite.
NC
Chapitre introductif : Pourquoi comparer les administrations publiques en Europe ?
Chapitre 1 : Des formes variées de « distribution des pouvoirs » entre layers of government.
Chapitre 2 : Au coeur des Etats : gouvernements et administrations centrales
Chapitre 3 : Comment devient-on fonctionnaire ? Recrutement, formation et socialisation.
Chapitre 4: Les carrières des fonctionnaires, un révélateur des dynamiques administratives.
Chapitre 5 : Regards sur l'activité politico-administrative dans la production nationale des politiques publiques.
Chapitre 6 : Une action publique de plus en plus territorialisée.
Chapitre 7 : Des administrations en « réforme » permanente : entre néo-managérialisme et nouvelle quête de cohérence.
Ce séminaire aborde les enjeux sociaux, économiques et politiques, mais aussi scientifiques et techniques, qui se posent dans la transition écologique. Il vise à proposer des clés de compréhension macroéconomiques et microéconomiques à partir de trois champ de littérature complémentaires : les transitions studies proposent d'aborder les dynamiques d'innovation en termes de co-évolution entre acteurs, organisations et institutions à différents niveaux du régime dominant ; l'économie écologique, en particulier dans sa manière systémique conceptuelle avec laquelle elle aborde la complexité et propose des outils d'évaluation/analyse/décision multicritères ; et l'économie/sociologie des conventions appliquée à l'environnement fournit un cadre de compréhension des enjeux de valeurs sociales qui justifient l'engagement écologique ou les décisions publiques. Les apports conceptuels et théoriques seront illustrés à partir d'enjeux de transition dans le secteur agricole.
Pour mieux comprendre les grands enjeux de transitions (écologique, sociale et sanitaire), ce séminaire aura pour but d’initier les étudiant.e.s aux problématiques liées à la santé environnementale sous l’angle du droit. À partir d’études de cas traitant à la fois des enjeux d’environnement et de santé, les étudiant.e.s pourront acquérir des connaissances sur le traitement juridique des risques avérés ou potentiels (perturbateurs endocriniens, nucléaire, pesticide, etc.), sur l’action préventive et l’approche de précaution, sur le cadre juridique de l’alerte en France, sur la responsabilité de l’État dans des affaires de « santé environnementale”» (amiante, chlordécone, pollution atmosphérique, biodiversité, climat, etc.).
Dans un contexte de renouvellement des inégalités dans le monde, ce séminaire de sociologie vise à explorer les différentes facettes des inégalités environnementales, non seulement, au regard des liens entre qualité environnementale et hiérarchies sociales, protection de l’environnement et lutte contre les inégalités socio-économiques et culturelles, mais également, entre justice environnementale et justice sociale. Il alterne des séances classiques, apportant une réflexion théorique alimentée par la discussion collective autour d’articles scientifiques présentés sous forme d’exposés, et des études de cas plus concrètes issues d’enquêtes de terrain en sociologie. Il s’attarde notamment sur l’émergence de l'Environnemental Justice comme cadre d'analyse des inégalités environnementales, sur les inégalités d’aces à la nature, sur la participation comme enjeu de justice environnementale ainsi que sur la question de la conversion écologique des modes de vies devant laquelle les différents groupes sociaux et les territoires sont en position très inégale.
Après avoir été représentative, la démocratie se doit aujourd'hui d'être participative. Aucune décision publique ne peut désormais être tenue pour légitime si elle n'a pas été préalablement « délibérée », notamment avec les « parties prenantes » qu'elle concerne. En présentant la riche littérature qui s'est constituée sur ce thème, notamment en sociologie politique, ce cours vise ainsi à montrer que la délibération et la participation forment une technologie de gouvernement de plus en plus répandue et routinière en France, concernant de nombreux domaines et de nombreuses échelles d'action publique. Pour autant et bien que cette « démocratie participative » soit présentée comme une innovation, voire une révolution, on insistera davantage sur la continuité entre celle-ci et la démocratie représentative, plus que sur une supposée rupture par laquelle la seconde remplacerait de plus en plus la première.
Cet enseignement de spécialité expose par un regard pluridisciplinaire des clés de compréhension de la santé publique, pour mieux en percevoir la complexité et mieux en comprendre les enjeux contemporains – enjeux mobilisant à la fois des savoirs techniques et politiques, pour un débat nécessaire autour de la santé. La pandémie de COVID-19 et les enjeux de la transition écologique ont rebattu les cartes de la place de la santé publique dans le débat public, et de fait, les questions sanitaires sont devenues centrales dans l’organisation de notre société. Crise de l’hôpital public, échec de campagnes de vaccination, creusement des inégalités sociales et territoriales de santé et scandales sanitaires environnementaux, autant de sujets qui font régulièrement la Une de nos médias. Les institutions en charge de la santé ne sont pas moins nombreuses, depuis un ministère et une direction générale de la santé, entourés d'une nuée d'agences plus ou moins indépendantes, de départements en charge du médico-social, de mairies et de régions impliquées dans la santé indirectement – par leurs compétences dans les transports, l'habitat ou l'aménagement urbain aux impacts sanitaires majeurs – produisant un système de santé complexe. Cet enseignement de 20h vise à apporter des éclairages sur les enjeux de santé publique aujourd’hui à partir de différentes disciplines scientifiques (épidémiologie, sociologie, sciences politiques, économie de la santé…). Il est composé de 10 modules dispensés par des enseignant.es chercheur.es ou professionnels membres de L’AAPRISS.
References
On finance
On green finance
On green innovation
On ecological economics versus environmental economics
On green growth versus post-growth
On epistemics of economics
Collectif de chercheur.e.s ATECOPOL
Ce module est un partenariat de Sciences Po Toulouse avec les chercheurs de l’Atelier d’écologie Politique (https://atecopol.hypotheses.org). L’ambition de ce nouvel enseignement pluridisciplinaire est de réfléchir de manière critique aux processus larvés de greenwashing et autres stratégies de dénigrement, en vue de « dépolluer le débat public »[1] et de penser des politiques de transition socio-écologique justes et soutenables. En partant du déni climatique, un décryptage des mécanismes aboutissant à l'inaction sera par ailleurs présenté. La présentation des trois biais caractéristiques de la pensée moderne que sont l’économisme, le solutionnisme technologique ainsi que le réductionnisme permettra d’engager une déconstruction des logiques systémiques de verdissement menées à la fois par les acteurs publics et privés. Cet enseignement proposera des thématiques ciblées en guise d’illustrations : véhicule propre, énergie décarbonée, avion vert, financiarisation de la biodiversité, logique de compensation, transition énergétique, etc. Enfin, le module s'appesantit sur les bifurcations possibles pour enrayer les ravages écologiques, à travers l’étude de propositions de la décroissance.
[1] Greenwashing : manuel pour dépolluer le débat public , ouvrage collectif publié aux éditions du Seuil, sous la direction d’Aurélien Berlan, Guillaume Carbou et Laure Teulières.
La consommation énergétique des sociétés contemporaines est vertigineuse : une seule centrale thermique britannique consomme aujourd’hui, à elle seule, quatre fois plus de bois que toute la Grande-Bretagne au milieu du XVIIIe siècle, pour produire seulement 1,5% de l’énergie consommée dans le pays. Les énergies fossiles et l'inertie des systèmes énergétiques hérités continuent à peser de tout leur poids, malgré le déploiement d'énergies considérées comme renouvelables, et s'accompagnent d'un cortège de questions géopolitiques et climatiques. La « transition énergétique » partout promue viserait à s'en défaire. Après être revenu sur les définitions techniques du champ énergétique, ce cours proposera une histoire contemporaine de l’énergie, partant de l’avènement des énergies fossiles dans les économies européennes au XVIIIe siècle, pour aller jusqu’aux transformations et scénarisations présentes. Par une histoire sociale, politique, économique et culturelle des énergies mobilisées lors de la croissance industrielle, ce cours tentera de dénaturaliser la grande accumulation d’énergies et de ressources qui caractérise les sociétés actuelles pour montrer les choix, les conflits, les impensés qui ont présidé à cette prolifération énergétique.
Stratégie climatique des organisations
Ce cours sera consacré à l'étude des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des organisations (privées et publiques), en se concentrant sur les aspects liés à la comptabilité carbone et à la quantification d'actions de réduction de GES tels qu'ils peuvent être appréhendés dans un cabinet de conseil. Suite aux compétences acquises lors de la formation Bilan Carbone, ce cours permettra aux étudiants d'acquérir des compétences pratiques pour concevoir et mettre en œuvre des plans de réduction des émissions de GES adaptés aux besoins et aux contraintes des organisations.
Résiliences territoriale
Ce cours consistera à s'approprier l'approche de résilience territoriale, c'est-à-dire la capacité d'un territoire à anticiper, réagir et à s’adapter pour se développer et maintenir ses fonctions de services essentielles ; ceci quelques soient les perturbations auxquelles le territoire doit faire face dans un monde contraint par le dérèglement climatique, la raréfaction des ressources, les techniques industrielles, les pandémies, les crises socio-économiques et financières etc. Il s’agira de préparer les étudiant.e.s à adopter une approche systémique des risques et des réponses à y apporter afin de sortir de la vision en silo des politiques publiques et à définir des objectifs stratégiques de politiques publiques selon les enjeux critiques d'un territoire afin d’apprendre à anticiper une crise plutôt que la subir.
L’équipe pédagogique (du parcours TERS, cours de spécialité, séminaire et atelier) comprend des universitaires (en sciences politiques, sociologique, géographie - aménagement, en Sciences de l’information, en droit public et privé), chargé.e.s de recherches à l’INRAE en économie, consultant.e.s dans le domaine du développement durable et la transition écologique.
Des modalités pédagogiques sur un double campus :
Les postes occupés par des anciens du parcours
Les structures d’embauche