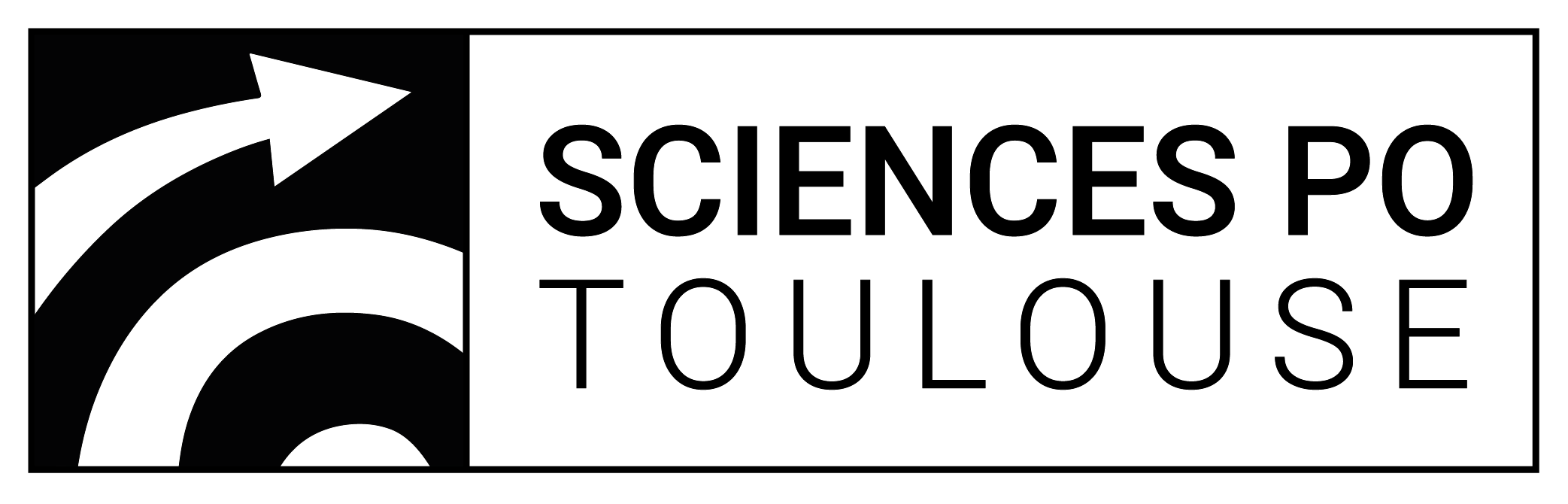En Bref
- Structure(s) de rattachement
- Durée de la formation
-
- 2 ans
- Stage(s)
- Oui, obligatoires
Aller au contenu Navigation Accès directs Connexion

Vous êtes ici :
Exemples de métier : chargé de mission, administrateur, consultant, porteur de projets, chargé de communication, de relations publiques en matière culturelle – établissements publics et privés, manifestations artistiques d’envergure, collectivités territoriales, nouveaux médias, tourisme…
Forte d’une tradition de recherche étroitement liée aux universités britanniques et états-uniennes, Sciences Po Toulouse a été l’une des premières institutions de recherche et d’enseignement à initier en France des séminaires consacrés aux cultures populaires et minoritaires (Cultural studies dont les subaltern studies, gender studies ou audience studies...). Le master de recherche et d’études Culturelles (Cultural Studies) de Sciences Po Toulouse prolonge cette tradition et propose une formation ambitieuse aux métiers de la culture, des médias et de recherche pour former des cadres opérationnels généralistes dans le secteur des arts et de la culture lato sensu, du tourisme, de la communication et des médias. Formation appuyée sur les travaux de recherche du LASSP, la culture est ici entendue dans une acception large incluant outre les arts, le livre et l’édition, le patrimoine et le spectacle vivant, les cultures populaires dont le cinéma, le rock, la BD, les cultures minoritaires (locales, étrangères, médiatiques, queer, etc.). L’éventail des débouchés est large (enseignement et recherche en sciences politiques et sociales, chargé de mission, administrateur, consultant, porteur de projets, chargé de communication, de relations publiques en matière culturelle – établissements publics et privés, manifestations artistiques d’envergure, collectivités territoriales, médias et nouveaux médias, édition…). Outre les indispensables connaissances techniques et l’approfondissement de leur culture de sociologie politique, de droit et d’économie de l’art et de la culture, de sociologie des médias et de la communication, en s’appuyant sur la sociologie des œuvres ou de la réception et la collaboration active de professionnels reconnus, les étudiants acquièrent par la pratique et développent des savoirs et savoir-faire, des protocoles et documents originaux et innovants pour améliorer la connaissance des publics des produits et institutions culturels (bases de données, enquête par sondages, focus groups…), pour optimiser leur communication tant interne qu’externe (usages de TIC, RH), pour cerner leurs environnements économiques et politiques, pour développer des capacités de travail en équipe et sur projets professionnels.
Filière à la fois sélective (limitée à 25 étudiants, dont 4 à 7 étudiants qui se destinent à la recherche) et innovante, le master Etudes Culturelles (Cultural Studies) de Sciences Po Toulouse multiplie les partenariats et innovations pédagogiques (le master Etudes Culturelles est notamment co-fondateur du programme de cours en ligne franco-espagnol MIRO, stages de terrain, voyages d’études, binômes chercheurs/professionnels, visites rencontres, projets professionnalisants, cours hors les murs, jeux de rôles, grandes conférences d’invités prestigieux J-.J Aillagon, en 2017 : James C. Scott de Yale University, M. Schudson de Columbia University...). Le master Etudes Culturelles s’ouvre ainsi aux métiers émergents et à l’international en bénéficiant des externalités des recherches menées au LASSP.
On compte parmi les anciens du master de recherches et d’études culturelles de Sciences Po Toulouse aussi bien des enseignants chercheurs (Clémentine Berjaud, maîtresse de conférence en science politique à l’Université de Paris 1 Sorbonne ou Flora Bajart, chercheure au CNRS) que quelques artistes (Sylvain Duthu du groupe Boulevard des airs) en passant par des administrateurs, programmateurs, porteurs de projets, chargé de mission et de projet dans les domaines de l’événementiel, des festivals, de la culture, du tourisme, de la communication et des médias et dans les établissements tant publics, privés que para-publics. Une majorité croissante des anciens diplômés travaille dans les grandes métropoles, à Paris ou à l’étranger. Les étudiants peuvent intégrer, le plus souvent en se réinscrivant dans une préparation spécifique, la fonction publique, en tant que cadres A via les concours d’administrateurs des établissements culturels (partenariat avec le TNT), des IRA, d’attachés territoriaux ou via des concours spécifiques (dont plusieurs dans l’éducation nationale, CAPES et agrégation sciences économiques et sociales, documentation …) ou en tant que contractuels dans les collectivités territoriales.
Les étudiants qui suivent en sus les séminaires Recherche réalisent des travaux de science politique au plus haut niveau portant sur la culture, les médias et les journalistes, les phénomènes de socialisation et d’engagement politiques ainsi que les opinions publiques, entendus dans une acception large et peuvent ensuite prétendre suivre une thèse au plus haut niveau. Les diplômés du master Etudes Culturelles de Science Po Toulouse ont ainsi obtenu par le passé des contrats doctoraux à l’université de Toulouse mais aussi dans d’autres universités (EHESS, autres IEP). Grâce au tronc commun les étudiants ne souhaitant plus poursuivre en thèse reconvertissent profitablement les compétences acquises vers d’autres débouchés professionnels.
L’équipe pédagogique compte une vingtaine d’intervenants professionnels associés à une douzaine d’enseignants et chercheurs habilités à diriger des recherches parmi les plus reconnus et publiant au plus haut niveau dans les domaines concernés, dont quatre collègues en poste à l’étranger, deux professeurs émérites et trois Directeurs de Recherche au CNRS.
Cet enseignement propose une vue panoramique des politiques culturelles et fournit des clés d’interprétation générales pour appréhender ce champ d’action publique complexe et foisonnant. Une première leçon, consacrée à la genèse, aux modèles et aux échelles des politiques culturelles sera suivie de l’analyse de quatre enjeux majeurs : la question des publics des politiques culturelles (démocratisation/démocratie, éducation artistique et culturelle, droits culturels, création participative, etc.), les politiques de soutien à la création artistique et l’action publique patrimoniale, les mutations contemporaines des dispositifs de soutien aux industries culturelles. Seront également évoquées des questions transversales – mondialisation, européanisation, digitalisation, « économicisation », rapprochement des enjeux environnementaux et culturels, etc. –, ainsi qu’un certain nombre de cas pratiques issus d’enquêtes de terrain réalisées en France et dans des pays étrangers.
Chaque séance aborde des questions théoriques en les illustrant par des cas pratiques tirés d’affaires ayant marqué la discipline
Un chapitre de 6 heures sera consacré à une initiation au droit de la propriété intellectuelle dans le contexte du secteur culturel (fondamentaux du droit d'auteur et du droit des marques).
NC
NC
NC
NC
NC
Le cours s’articule autour de trois questions. La première, historique, évoque l’émergence de la conscience patrimoniale à la Renaissance et la constitution de la règlementation depuis l’époque révolutionnaire. La seconde sera la mise en place des principes, structures et règlements en matière de conservation et de protection patrimoniales : les théories, la déontologie, les pratiques. Une étude de cas sur les enjeux du patrimoine religieux, thème d’une actualité extrême, permettra de rendre concrètes ces questions, afin de comprendre comment le statut de certains objets ou monuments a une incidence directe sur leur gestion patrimoniale, leur conservation, leur restauration, leur muséalisation et leur médiation auprès des publics. Les rencontres avec des professionnels du patrimoine permettent d’aborder les nouvelles mutations des processus de patrimonialisation, les actions concrètes des services Etat/Région.
NC
Cet atelier pratique proposé sur l'année entière permet aux étudiants d'aborder la conception et la réalisation d'un projet culturel. Pensé sur l'année entière, il aboutit à deux jours d'événements autour de “l'émergence artistique en région toulousaine”.
NC
NC
Ce cours constitue une introduction à la gestion et à la comptabilité, discipline qui n’a pas été abordée à l’IEP au cours des trois premières années du cursus. Cette discipline est distincte et indépendante de la science économique. Le cours présente les principes comptables en termes d’emplois et de ressources. Il permet de répondre aux questions suivantes : comment et où trouver des informations utiles aux décideurs ? Les documents de synthèse, bilan et compte de résultat, sont présentés dans les grandes lignes et analysés. Les notions de fonds de roulement, besoin en fonds de roulement et trésorerie sont abordés. L’analyse du compte de résultat permet de mettre en évidence la rentabilité et la performance d’une entité. Enfin les outils de gestion, tels que le seuil de rentabilité et les budgets sont appréhendés.
NC
Le cours propose dans une première partie les clefs d’entrée dans un parcours doctoral, via les conditions de sélection et de financement du côté institutionnel, et via l’appréciation des motivations scientifiques conduisant au choix de ce parcours. Il compare l’organisation des études doctorales au niveau international, et décrit les spécificités disciplinaires en matière d’attendus du diplôme adoptées par les communautés scientifiques. Le cours présente ensuite l’environnement social et professionnel du doctorat et l’organisation des études doctorales.
Dans une deuxième partie, le cours expose l’intégralité d’une carrière scientifique et l’organisation des institutions et structures de recherche, en pointant les différences entre les systèmes académiques et scientifiques nationaux. Il se concentre enfin sur les questions d’évaluation et de reconnaissance scientifiques, étudie l’ensemble des incitations publiques et professionnelles qui régissent les communautés de recherche, et conclut sur les enjeux contemporains et les évolutions récentes des carrières et structures scientifiques.
Après une présentation des enjeux et défis de l’urgence climatique, les grandes étapes de la construction du régime international du climat ainsi que les impasses de cette gouvernance seront retracées. Les principaux instruments politiques et juridiques des politiques climatiques de l’Union européenne ainsi que le cadre législatif et réglementaire français seront délivrés aux apprenant.e.s dans une perspective critique en illustrant notamment les points de tension et de difficultés de mise en œuvre que rencontrent les États et en particulier la France. Les différents acteurs de la gouvernance climatique impliqués seront évoqués tout au long de l’enseignement (États, OI, entreprises, citoyens, Experts, ONG). Les actions en justice visant à contester le manque d’action des États et à demander des comptes aux principaux émetteurs de GES (Carbon major) seront exposées pour finir.
Dans cette intervention de 10h, le choix a été fait de s’intéresser cette année aux groupes minoritaires racisés. Plus précisément, il s’agit de proposer des éléments d’une histoire politique de la question raciale dans la France contemporaine. Cette mise en contexte sera ensuite mise en perspective avec un certain nombre de positionnements et de controverses qui traversent les sciences sociales autour de la question raciale.
Objectif du cours :
Ce cours a pour objectif de développer la compréhension et les compétences des étudiants dans la promotion et la gestion de la qualité de vie au travail (QVT). Ce sujet crucial s'inscrit dans l'évolution actuelle du monde du travail, où la satisfaction, le bien-être et l'épanouissement des employés sont devenus des facteurs clés de succès pour les organisations. Le cours explorera les concepts fondamentaux de la QVT, les facteurs qui influencent la QVT, et comment le management peut jouer un rôle pour l'améliorer. Les stratégies de gestion favorisant un environnement de travail inclusif, respectueux et productif seront présentées.
Compétences acquises à l’issue du cours :
Comprendre et expliquer les concepts fondamentaux de la qualité de vie au travail.
Identifier les facteurs qui influencent la QVT dans divers contextes organisationnels.
Proposer des stratégies d'amélioration de la QVT adaptées à différents types d'organisations.
Utiliser des compétences de leadership pour promouvoir la QVT au sein d'une équipe ou d'une organisation.
NC
Cet enseignement est basé sur l'approche ethnographique de longue durée mise en oeuvre par les deux enseignants, à la fois sociologues et danseur (Sorignet) ou musicien (Perrenoud) professionnels. On y abordera les principaux thèmes qui balisent la sociologie contemporaine du travail artistique et permettent en outre de penser les inégalités sociales à une plus grande échelle : historicisation de la figure sociale de l'artiste, déconstruction des notions de « talent » ou de « vocation », analyse de la formation des catégories de classement socio-esthétique, de la naturalisation des inégalités, de la généralisation d'une précarité « créative », et de l'euphémisation des rapports de domination.
Le cours se fonde sur l'une des périodes majeures de l'histoire de l'art occidental, la Renaissance Italienne. Il s'agira d'aborder ce mouvement de manière thématique en s'interrogeant sur des notions et des principes aussi divers que : la définition de la Renaissance, l'invention du statut de l'artiste, la naissance de l'histoire de l'art, le développement de l'archéologie, la naissance d'une conscience patrimoniale ? Cette diversité des approches permettra de s'interroger sur les différentes méthodes utilisées en histoire de l'art, l'histoire culturelle de l'art et l'histoire sociale de l'art par exemple.
Chaque séance aborde des questions théoriques en les illustrant par des cas pratiques tirés d’affaires ayant marqué la discipline, le cours étant découpé en trois grandes thématiques:
Thème 1- LIBERTÉS.
Séance 1- Le procès de Charlie Hebdo : Liberté de la presse – droit à la caricature et à la satire – liberté de conscience et de religion – protection des tiers et du droit des croyants – pénalisation/ non pénalisation du blasphème- usages militants du droit de la presse – stratégie juridique des collectifs militants et des mobilisations.
Séance 2 – Art et sexisme : Le sexisme, comme problème public; le sexisme dans l'histoire de l'art/ dans les pratiques culturelles, productions populaires/savantes; la pénalisation du sexisme: le sexisme comme forme des violences de genre et des violences faites aux femmes; défnition et qualifcation juridiques des pratiques et violences sexistes (injures sexistes, outrage sexiste, harcèlement sexuel, agressions sexuelles, viol, etc.) sexisme et liberté de création et d'expression artistique: l'affaire Orelsan.
Thème 2 - PROPRIETÉ
Séance 3 et 4 : Le droit de la propriété intellectuelle – droit de la propriété littéraire et artistique – notion de plagiat , de contrefaçon, de parasitisme – droits voisins.
Thème 3 – INSTITUTIONS CULTURELLES
Séance 5- Les institutions du spectacle vivant: le cas des festivals.
Séance 6 -Les musées – droit des musées. Création/institutionnalisation d'un projet muséal.
Thème 4 – MARCHÉ DE L'ART
Séance 7 – Art contemporain et blanchiment d'argent. Voir l'affaire de la toile « Hannibal » de Basquiat
1 – Principes et modalités du financement public et privé du secteur culturel.
Le modèle économique des politiques culturelles en France repose à 90% sur des aides publiques s'articulant sur des financements croisés (Europe, Etat et collectivités territoriales). Dans un contexte de restrictions budgétaires comment appréhender les logiques d'intervention de ces différents partenaires et se positionner intelligemment dans cet échiquier ? Un focus sera apporté sur le mécénat culturel.
2- Economie de production du spectacle vivant : Tva culturelle, Intermittence…
Montage d'une production théâtrale : Élaboration d'un budget de production, droits d'auteur, engagement de personnel, notions de communication et de diffusion d'un spectacle.
Apport théorique et choses plus pratiques également. Communication de documents de travail (contrats d'engagement , de cession, matrice de budgets...) qui seront autant d'outils pour leur vie professionnelle. Proposition d'ouverture à d'autres disciplines notamment la musique qui semble être un champ artistique auquel tiennent les étudiants.
Ce séminaire entend rompre avec certains lieux communs et fausses oppositions professionnelles : haute et basse culture, amateurs et professionnels, culture et médias, culture et sport, offre et demande, démocratie et démocratisation culturelles... Il revient mais autrement sur ces enjeux fondamentaux pour l'avenir des métiers de la culture. Le séminaire, sa raison sociale l'indique, insiste particulièrement sur l'indissociabilité des pratiques et politiques culturelles, des dispositions et des dispositifs. L'intérêt pour le cinéma dit d'art et d'essai, comme pour tel patrimoine, le rap ou l'opéra peut s'inscrire dans l'histoire longue ou dépendre d'un héritage familial mais il ne peut perdurer qu'au travers de l'entretien de ces dispositions favorables (au cinéma, aux musées, à la BD ou à l'opéra) par des politiques (publiques, associatives, médiatiques, privées) idoines. Un « public » (du théâtre d'avant-garde ou classique, du nouveau roman comme d'un festival punk, d'un jardin public, d'un match de foot ou d'un musée du costume...) s'avère lui-même être le produit et le vecteur de ces politiques. L'internationalisation, le numérique, les nouveaux médias et la dérégulation mais aussi le désinvestissement des Etats, l'urbanisation, le vieillissement des populations européennes, la hausse du niveau culturel... transforment en profondeur les rapports à la culture que les étudiants analyseront également en pratique à partir d'études de cas réalisées en groupe. On mobilisera dans ce but plus particulièrement les outils d'évaluation des publics (audit, statistiques, questionnaires, entretien, livre d'or...).
Anglais spécialisé | 20H - 2 ECTS
Afin de pallier au manque de connaissances spécifiques des étudiants « recherche » du master en matière de journalisme, nous avons décidé depuis la rentrée dernière de modifier notre manière de présenter ces problématiques. Nous avons en effet emmené les étudiants pendant deux jours en mini-stage d'observation à la rédaction de France 3 Midi-Pyrénées. Une dizaine d'entretiens ont été réalisés et de multiples observations réalisées.
Observer le travail journalistique permet en effet d'une part de rendre sensibles les étudiants à des caractéristiques bien connues des sociologues du journalisme mais qu'il est difficile d'intégrer en 20 h : le caractère très collectif du métier qui coexiste avec des rapports variés, voire opposés, de ce même métier ; le caractère très « fragile » du processus de production (qu'on ne peut saisir en n'étudiant que les produits finis dont ils sont le résultat) : assister en régie à un JT catastrophique (absence de liaisons en direct, sujet diffusé sans son, etc.) est ainsi pédagogiquement très « productif ». Par ailleurs, il s'agissait de « normaliser » l'étude du journalisme auprès d'étudiants qui ne travaillent pas sur ce sujet : l'an passé ils ont ainsi pu faire « travailler » des problématiques développées par ailleurs dans leur propre travail (question du genre, sociologie des professions, etc.).
Ce court passage sur le terrain était encadré de séances préparatoires (présentation de la rédaction étudiée, précautions méthodologiques et logistiques, etc.) puis de séances visant à l'exploitation du matériau recueilli (mise au propre des comptes rendus, exploration des pistes d'analyse, conseils bibliographiques). L'évaluation a porté sur une note de recherche (format article scientifique) rédigée collectivement. La qualité de ce travail nous incite à poursuivre sous la même forme cette année en y ajoutant une difficulté supplémentaire (pour les étudiants) qui devront trouver et négocier le terrain (pour cette première année nous l'avons proposé « clés en mains »).
2020-2021 : Enquête sur les élections régionales
Le choix d’une méthode d’enquête n’est jamais neutre. D’où l’importance de pratiquer le pluralisme méthodologique et de lier réflexions méthodologique, éthiques et épistémologique pour cet apprentissage du métier de sociologue. L’enquête collective de l’année portera sur les élections régionales de 2021, de la constitution des listes à la formation des opinions et jugements politiques des électeurs. On creusera plus spécifiquement l’impératif réflexif, l’auto-socio-analyse du ou de la chercheur.e, à tous les stades de l’enquête depuis la rupture avec les prénotions et la construction de l’objet jusqu’à l’écriture finale de l’article scientifique en passant par la charge de la preuve. La méthode ne pouvant s’enseigner ex cathedra le séminaire alterne donc enquêtes in situ (par exemple : rédaction, administration d’un questionnaire et interprétation de ses résultats, observations collectives de meetings, travail sur archives à la délégation régionale de l’INA, entretiens collectifs, objectivations statistiques de la constitution des listes candidates…) avec des enseignements plus théoriques.
Thème 2020-2021 : Les socialisations politiques. La fabrique des habitus. Continuités, conversions, clivages d’habitus
Le séminaire portera cette année universitaire sur la fabrique ou la socialisation politique des habitus clivés, la conversion des habitus, dont la radicalisation politique. Nous bénéficierons notamment cette année de la venue au LASSP à Toulouse de G. Dorronsoro, D. Gaxie et L. Bonelli, très certainement au second semestre. Dans le cadre de la préparation de ces événements scientifiques, nous questionnerons ensemble les façons dont les rapports sociaux se croisent et se combinent en étudiant de concert les socialisations ethniques, genrées et de classe mais aussi celles religieuses parmi d’autres points aveugles des travaux sociologiques dont le rôle joué par les médias et les traumatismes biographiques. Le séminaire se poursuivra ensuite au second semestre sur la socio-analyse.
Le métier d'éditeur à l'âge industriel : ce qu'il reste d'artisanal dans la production des livres, les divers métiers impliqués (préparation de texte, traduction, correction, mise en page, graphisme, production, /commercialisation, financement, communication) et les rapports de collaboration et de concurrence entre les différents pôles responsables de l'institution d'une ligne éditoriale.
L'espace de l'édition indépendante (de Maspero à nos jours) ou Comment raconter le dernier demi-siècle d'histoire politique au travers de la production éditoriale.
Ce module propose une initiation aux méthodes professionnelles de la mise en page de documents et une présentation de la chaîne graphique en général.Théorie et mise en pratique des méthodes de retouche d'image et de mise en page professionnelles. Utilisation des logiciels InDesign et Photoshop.
Les interventions porteront sur le domaine du cinéma. La première intervention sera centrée sur le secteur cinématographique considéré sous l’angle de la production et de la « création » ; on s’interrogera notamment sur la diversité de la production en attachant une importance particulière aux contraintes économiques propres à cette activité culturelle et aux variations nationales. La seconde intervention traitera des consommations et des goûts cinématographiques en France, en relation avec les débats contemporains qui traversent l’analyse sociologique des pratiques culturelles.
Présentation globale du secteur (le disque/la scène) et de ses actuels bouleversements (concentration des structures en France, pratique du 360, recul des financements publics). Et donc des conséquences à court terme de ces changements en cours sur l’organisation du secteur.
L'expérience de l'intervenant dans le secteur des Musiques Actuelles tourne autour de 2 activités :
NC
Pôles majeurs du budget du ministère de la culture et des missions des DRAC, le spectacle vivant/création, ses multiples déclinaisons et le(s) patrimoine(s), relèvent de processus historiques bien différents. Pourtant, les nouveaux enjeux de ces deux secteurs culturels et économiques se manifestent notamment dans leurs modalités d’interactions : patrimonialisation du travail artistique et processus de création au service de la médiation patrimoniale. Les rencontres avec des professionnels de la DRAC, des services départementaux et municipaux et d’autres structures culturelles et patrimoniales permettront d’aborder très concrètement ces nouvelles mises en oeuvre.
Ce cours présente la notion d'interculturalité à travers, d'une part, l'histoire et les mutations des dynamiques qui existent entre la-les culture-s des individus, des groupes dans une société plurielle ; d'autre part, à travers les disciplines qui l'analysent. A cette approche théorique est associée la notion de management à partir d'une réflexion sur le tourisme interculturel, les questions qu'il soulève au sein d'un nouvel espace de communication et de déplacements.
Ce cours est dispensé entièrement à distance, par le biais d'une plateforme (Moodle).
Mémoire professionnel | 25 ECTS